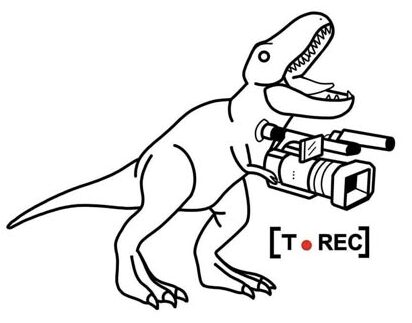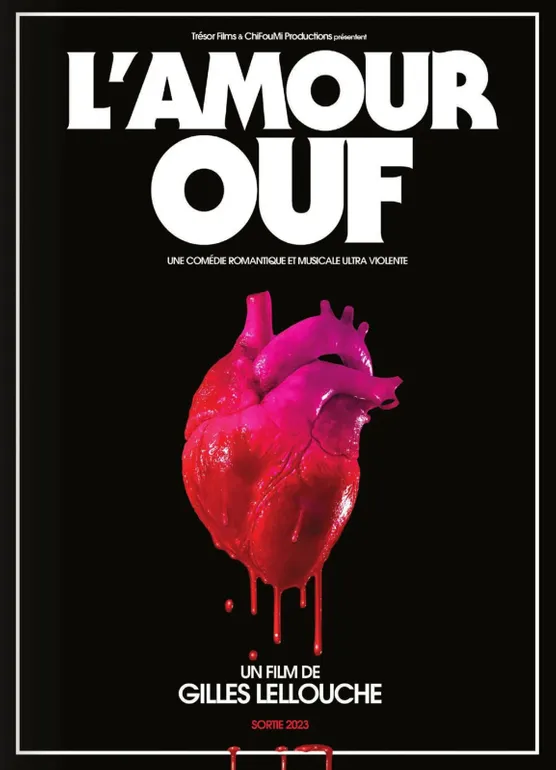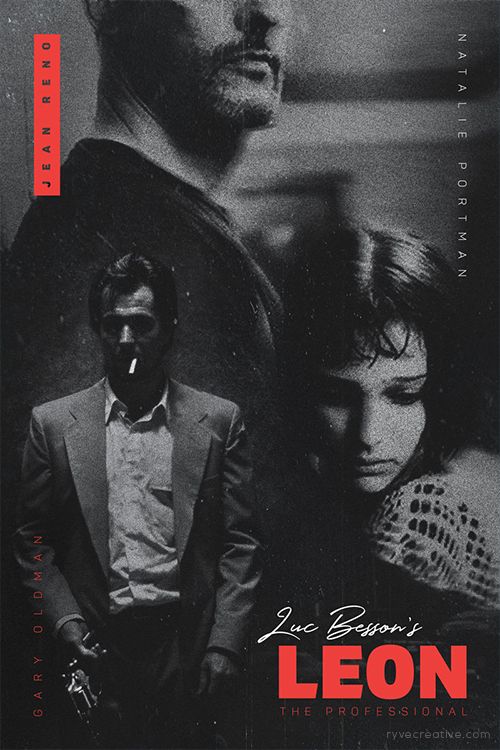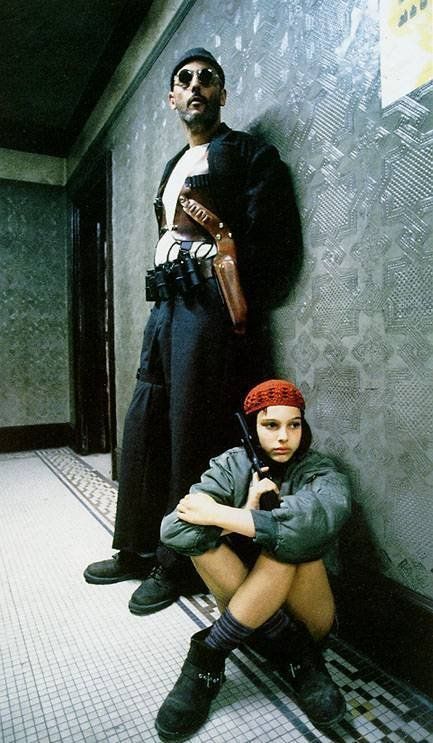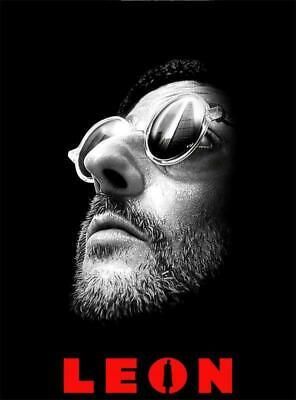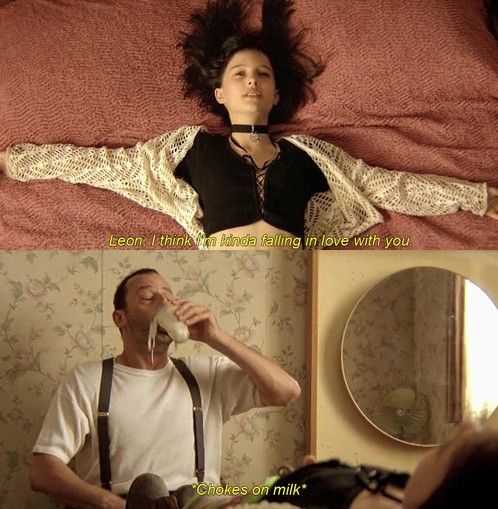La naissance du projet
Le 15 novembre 2024, Damso a créé la surprise en sortant son nouvel album J’ai menti, un projet qu’il n’avait pas du tout prévu. Alors qu’il avait déjà annoncé un nouvel album pour mai 2025, l’artiste a pris tout le monde de court en dévoilant un EP qu’il a écrit rapidement, qui s’est finalement transformé en un véritable album. Une démarche inattendue, mais qui témoigne d’une spontanéité et d’une créativité sans limites.
Son écriture
L’album J’ai menti se distingue par son écriture rapide, où Damso semble vouloir s’exprimer sans filtre, avec une urgence palpable. Ce qui frappe dans ce projet, c’est l’évolution musicale de l’artiste. Bien que son style soit reconnaissable, Damso a décidé de sortir de sa zone de confort et de jouer avec de nouvelles sonorités. L’album navigue entre des influences trap et des beats plus dansants, inspirés notamment par le shatta et les sonorités afro-trap, un changement notable par rapport à ses précédents projets. On retrouve ainsi une touche plus légère, presque estivale par moments, qui contraste avec les atmosphères plus sombres et introspectives de ses anciens albums.
Mais J’ai menti ne se contente pas de suivre les tendances. Damso y explore des thématiques qui lui sont chères : les relations complexes, les conflits intérieurs, et bien sûr, sa vision de l’amour et de la société. Ses textes restent aussi percutants que d’habitude, oscillant entre poésie brute et réflexions profondes sur sa propre identité.
Les feats

L’album comprend plusieurs collaborations qui enrichissent cette nouvelle direction musicale. Parmi les invités, on retrouve Angèle, qui apporte une touche plus pop et mélodique à un morceau particulièrement lumineux.
Kalash, l’artiste reggae-dancehall, fait aussi une apparition, ajoutant une dimension caribéenne et festive à l’ensemble, tandis que Kalash Criminel amène son flow agressif et sa signature trap à l’album, apportant un contraste intéressant avec les autres featurings plus doux.
Production
En termes de production, J’ai menti se distingue par sa diversité. Si Damso conserve son côté introspectif et poétique, il réussit ici à marier des influences extérieures tout en restant fidèle à lui-même. C’est un album qui, tout en explorant des territoires musicaux nouveaux, n’oublie jamais d’être authentique. En seulement quelques mois d’écriture, Damso parvient à nous surprendre, nous embarquer dans un projet frais, mais qui ne manque pas de profondeur.
En conclusion, J’ai menti est un projet audacieux et risqué, mais qui montre que Damso, loin de s’endormir sur ses acquis, continue de repousser ses limites. Cet album est une belle surprise, qui offre une palette de sonorités variées, tout en explorant des thèmes forts et personnels. Un projet où l’artiste s’affirme, une nouvelle fois, comme un créateur insatiable et toujours en mouvement.